Le Code noir n’est toujours pas aboli. Interpellé à ce sujet par Laurent Panifous, député du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT), François Bayrou, Premier ministre, découvrait mardi 13 mai, le maintien de l’édit royal. D’abord surpris, le chef du gouvernement s’est ensuite engagé à abroger le texte juridique régissant l’esclavage. Présenté au Parlement, le texte sera, il l’espère, adopté à l’unanimité.
Nicolas Butor, professeur de Sciences de la Vie et de la Terre et militant du collectif Survie, une association qui travaille sur le colonialisme et le néocolonialisme, et rédacteur de la revue Billets d’Afrique, décrit le Code comme un moyen de "légaliser, organiser, rationaliser l’exploitation humaine la plus abjecte", et ce faisant, constitue un "crime contre l’humanité".
Que contient-il ?
Encadrant les punitions, obligeant les baptêmes catholiques, définissant l’esclave comme un meuble, c’est-à-dire l’unique bien de son maître, le Code inscrit pour "la première fois qu’être esclave, c'est être noir". Le mot “nègre” apparaît aux articles 4 et 40. Aucun autre groupe ethnique n’est évoqué. Pour Nicolas Butor, l’édit est "le point de départ du racisme tel qu’on le connaît aujourd’hui en France".
À écouter : Remboursement de la double dette d’Haïti : "La société civile est porteuse de ce sujet depuis des années", affirme l'auteure Monique Clesca
En 1685, le Code noir de Colbert a codifié l'esclavage, réduisant des êtres humains au statut de biens meubles. Son abrogation formelle doit être immédiate ! C’est ce que nous avons demandé au gouvernement aujourd’hui. #Histoire #JusticeRéparatrice #AbolitionEsclavage #qag pic.twitter.com/Os8sodzrxX
— Olivier SERVA (@olivier_serva) May 13, 2025
Initié par Jean-Baptiste Colbert, ministre de la Marine et des Colonies de la France sous le roi Louis XIV, il est publié en 1685. Avant cette date, des lois locales étaient d’usage. Le Code noir établit une loi unique permettant "de mettre un peu d’ordre dans le droit français". Annulé grâce à la fin de l'esclavage en 1794, il resurgit en 1802 sous Napoléon Bonaparte et sera maintenu jusqu'à nos jours. Sa création marque le début de la législation coloniale française. Il est aussi un moyen pour l’autorité royale de réaffirmer son pouvoir sur ses terres.
À lire : 1825–2025 : comprendre deux siècles de domination post-coloniale entre la France et Haïti
Le Code prévoit des mesures pour protéger ces personnes opprimées. Leurs maîtres ont le devoir de les nourrir, de les vêtir ou de les soigner. Faisant dire à "certains historiens" que, d’une façon, ces articles seraient "presque positifs pour l’amélioration des conditions de vie de ces personnes". La réalité est différente puisque “ça n’a pas du tout été fait par philanthropie”. Mais plutôt par intérêt financier, car avoir une main-d’œuvre en bonne santé multiplie "la rentabilité".
"La France n'a jamais abrogé le Code Noir !"@LPanifous (LIOT) alerte le Gvt sur la non-abrogation "formelle" du Code Noir : "Applicable ou pas, nous parlons ici de dignité humaine. […] L'heure est venue pour la République de se laver de cette ignominie !"#DirectAN #QAG pic.twitter.com/f2oNVZExLL
— Assemblée nationale (@AssembleeNat) May 13, 2025
Une histoire actuelle
Le Code noir signifie aussi le début du droit d’exception colonial. En métropole, ce système avait été aboli au XIVe siècle, et toute personne asservie arrivant en Hexagone était automatiquement affranchie. Une mesure inexistante pour ses colonies. Le militant relève d’autres utilisations de ce droit d’exception plus récentes : notamment pour le scandale du chlordécone. Ce pesticide classé comme un cancérigène probable pour l’homme dès 1979 est interdit en France hexagonale en 1990. Trois ans plus tard, son utilisation aux Antilles est proscrite. Une dérogation ministérielle a prolongé son emploi. Ces départements d’outre-mer font actuellement partie des territoires où le nombre de cancers est le plus haut au monde.
L’esclavage, la colonisation et la traite négrière laissent encore des stigmates, regrette Nicolas Butor. Il appelle à faire un travail mémoriel et de réparation, en expliquant le caractère systémique de l’histoire tout en le reliant au présent.
Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nousEnvie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous

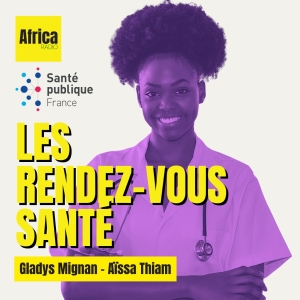




L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.