Les syndicats peuvent-ils encore incarner la colère sociale ? Acteurs historiques des luttes solidaires, ils rassemblent les travailleurs et mobilisent des foules imposantes. Pourtant, des critiques sur la stratégie d’action, la représentativité ou la capacité à porter des causes transformatrices interrogent une partie des partisans du mouvement Bloquons tout. Même si les revendications sont communes, les méthodes, elles, ont du mal à émerger.
À main levée, militants, membres des syndicats Sud Rail, CGT, collectif queer et judiciares votent leurs quatre revendications : s’opposer au président Emmanuel Macron, à Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre, obtenir la régularisation de tous les sans-papiers et la fin du génocide dans la bande de Gaza. Un dernier point reste à trancher avant le départ du cortège de la Gare du Nord vers Nation. Une nouvelle fois, les mains se dressent : c’est décidé, ce sont les plus jeunes qui mèneront la foule. Seuls les inattentifs, les journalistes, les gendarmes et les policiers positionnés tout autour d'eux ne se sont pas exprimés. Sur tout le territoire, un dispositif de 80 000 agents des forces de l'ordre à été déployé.
La colère descend dans la rue
Bras dessus bras dessous, pancartes ou fumigènes en mains, la foule chante à pleins poumons. Anthony Auguste marche entouré de ses collègues de la SNCF. Délégué Sud Rail basé dans la région Paris Nord, il s’est syndiqué, en 2017, après "avoir pris conscience que beaucoup de choses n’allaient pas" dans son travail. Le cheminot explique que, pour faire reculer les plans d’austérité budgétaire, il est nécessaire selon lui de faire grève, de paralyser les déplacements des travailleurs, car si "la SNCF s’arrête, les trains ne roulent pas, ou en tout cas difficilement, et du coup les gens ne vont pas au boulot".
La grève, au-delà d’instaurer un moyen de pression, offre à la lutte une visibilité importante, se réjouit Wassim. "Après, il ne faut pas que les gens se sentent obligés de s’affilier à un syndicat ou quoi… Enfin, tout le monde peut venir", ajoute-t-il. Pour le jeune réalisateur freelance, les organisations syndicales sont un point de départ. Pour faire progresser leurs causes, "il faut que les gens soient indépendants et s’organisent entre eux, en dehors des syndicats", afin de mettre en place des actions plus stratégiques pour se rapprocher des "lieux importants politiquement", explique-t-il.
Entre slogans et gaz lacrymogènes
À l'approche du point d'arrivée, le ton change. L’air embrumé par les gaz lacrymogènes devient piquant. La tête du cortège s’était faite silencieuse, mais le fracas des bouteilles et des détritus aux pieds et aux nez des CRS la rompt par à-coups. Les forces de l’ordre chargent et l’immense groupe se presse vers la place de la Nation, où chaque sortie est gardée par des camions bleus et leurs hommes.
Sur un bout de la place, une petite partie des manifestants continue de lancer des bouteilles d’eau à moitié vides, des marrons et des cailloux sur les CRS qui foncent sur eux, matraque en main. Les colonnes de manifestants affluent sur la place. En trottinant, chantant et dansant, ils contournent l’agitation et quittent Nation.
Syndicats à l’épreuve
À mesure que les militants s’étiolent, les gendarmes poussent avec de plus en plus de force les jeunes. Trente et une personnes sont arrêtées. Emma a les yeux rivés sur cette scène. Elle regrette le départ des groupes syndicaux. "Je trouve ça dommage qu’on n’ait pas pu se rassembler sur la place, essayer de faire un truc où on pourrait discuter tous ensemble, faire des conférences, un vrai moment d’échange." Pour elle, c’est aussi le rôle des syndicats d'"essayer d’organiser la fin de la manif".
Elle gardera un bon souvenir de cette mobilisation et espère qu’il sera possible que syndicats et militants plus violents puissent réfléchir ensemble.
Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nousEnvie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous

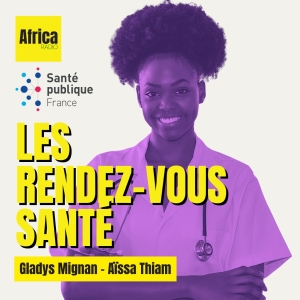




L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.