La liberté de la presse est de plus en plus fragile. Les médias se débattent entre la garantie de leur indépendance et leur survie économique. Reporters sans frontières (RSF) publie, ce vendredi 2 mai, son classement mondial de 2025. Une analyse qui, cette année, s’est focalisée sur les pressions économiques.
À lire : Nigeria. Une chanson du rappeur Eedris Abdulkareem, critiquant le président, interdite de diffusion
En Afrique comme ailleurs, la liberté de la presse recule, en particulier à cause des conflits, des dictatures et des problèmes économiques. RSF alerte sur une dégradation globale et inédite de la liberté de la presse. Pour la première fois depuis la création du classement en 2002, la situation mondiale passe en zone “difficile”, avec un score moyen inférieur à 55 points. Cela signifie que, dans la majorité des pays, il devient de plus en plus compliqué pour les journalistes de faire leur travail librement et en sécurité.
Pour 80 % des pays africains, la liberté de la presse s'est réduite
Plus de 60% des pays évalués, soit 112 sur 180, enregistrent une baisse de leur score. Dans la moitié d’entre eux, les conditions d’exercice de la profession sont jugées difficiles voire très graves, et moins d’un quart seulement présentent une situation satisfaisante.
🔴 #RSFIndex2025 | In 2025, less than 1% of the world's population lives in a country where press freedom is fully guaranteed. #WPFD2025 #WorldPressFreedomDay
— RSF (@rsf.org) 2 mai 2025 à 06:05
[image or embed]
Parmi les causes majeures de cette détérioration figure la pression économique sur les médias. Cette charge s’exerce via la concentration de la propriété des médias, les pressions des annonceurs, l’attribution opaque ou insuffisante des aides publiques, et surtout la domination croissante des géants du numérique sur les revenus publicitaires. Ces plateformes digitales captent une part grandissante de l’investissement publicitaire, contribuant à fragiliser le modèle économique traditionnel de la presse et à accroître la dépendance des rédactions.
À lire : Liberté de la presse au Burkina Faso : la principale association de journalistes dissoute par les autorités
La liberté de la presse régresse de manière inquiétante dans une grande partie de l’Afrique, notamment à cause de la concentration des médias et de leur dépendance économique. Dans 80 % des pays africains, le score économique lié à la liberté de la presse s’est détérioré. Les médias sont souvent contrôlés par des groupes privés proches du pouvoir, ce qui limite l’indépendance éditoriale.
Le manque de subventions publiques fiables affaiblit encore les médias
Cette concentration se retrouve particulièrement au Nigeria, au Cameroun ou en Sierra Leone. De plus, les revenus des médias dépendent souvent de la publicité financée par l’État ou de grandes entreprises, comme au Bénin ou au Togo. Cette dépendance pousse de nombreux journalistes à s’autocensurer, de peur de perdre ces financements. Au Kenya, par exemple, le journal The Nation a perdu des publicités après avoir révélé des informations sensibles.
À lire : Burkina Faso : arrestation de deux journalistes après des critiques sur la liberté d'expression
Le manque de subventions publiques fiables affaiblit encore les médias. Dans certains pays comme la Mauritanie ou le Sénégal, les aides de l’État sont rares, mal distribuées ou soumises à des critères opaques. Cette précarité financière rend les rédactions plus vulnérables aux pressions économiques et politiques.
🔴 #RSFIndex | RSF has released the 2025 World Press Freedom Index 1: Norway 🇳🇴 2: Estonia 🇪🇪 3: Netherlands 🇳🇱 20: United-Kingdom 🇬🇧 25: France 🇫🇷 49 : Italia 🇮🇹 57: United States 🇺🇸 126: Algeria 🇩🇿 159: Türkiye 🇹🇷 176: Iran 🇮🇷 178: China 🇨🇳 179: North Korea 🇰🇵 180: Eritrea 🇪🇷 Learn more here: rsf.org/en/index
— RSF (@rsf.org) 2 mai 2025 à 06:10
[image or embed]
Dans des régions en proie à l’insécurité, comme le Sahel ou l’est de la République démocratique du Congo, l’activité journalistique est menacée. Au Mali et au Burkina Faso, certains médias ont dû fermer, et des journalistes ont été déplacés ou contraints à l’exil. Dans des cas extrêmes, des journalistes burkinabè critiques ont été enrôlés de force dans l’armée.
L’Érythrée occupe la dernière place mondiale
Les pressions ne sont pas que sécuritaires. Dans plusieurs pays, les autorités utilisent la justice ou des instances de régulation pour sanctionner des médias. En Guinée, le retrait de licences a entraîné la perte de centaines d’emplois. Au Mali, la suspension d’une chaîne pendant six mois a gravement réduit ses revenus.
À lire : Niger : Amnesty International dénonce des violations des droits humains depuis le coup d'État
Plusieurs pays africains sont dans les derniers rangs. L’Ouganda, l’Éthiopie, le Rwanda et le Burundi reculent fortement. L’Érythrée occupe la dernière place mondiale, sans aucun média indépendant. À l’inverse, certains pays comme l’Afrique du Sud, la Namibie, le Cap-Vert ou le Gabon restent bien classés.
La France, quant à elle, a glissé de quatre places et figure en 25e position. Un déclassement dû à la concentration des médias entre les mains des grandes fortunes, qui remettrait en cause l’indépendance éditoriale et favoriserait l’autocensure. L’environnement économique fragilise encore plus un secteur confronté à la domination des géants du numérique.
Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nousEnvie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous

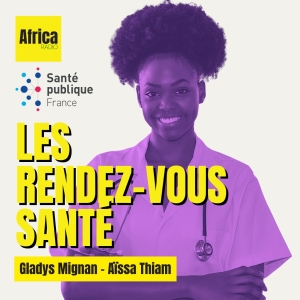




L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.