La cinquième édition de votre festival Afrique en Visions se poursuit jusqu’au lundi 1er décembre. La dernière édition était plus politique. Cette année, la programmation est davantage axée sur la diversité des regards et des thématiques, comme la vie conjugale ou la décolonisation. Pourquoi avoir choisi cette diversification des idées, des sujets, des perspectives ?
Malgré cette diversification des sujets, il n’en demeure pas moins qu’ils sont aussi politiques, parce que le cinéma, et le cinéma africain et afro-diasporique notamment, sont politiques par essence. On fait des narrations, on fait des récits pour porter des histoires au monde, avec un regard in situ, avec un regard africain, mais qui est ouvert sur le monde et qui résonne avec le monde.
Donc cette année, comme chaque année d’ailleurs, ce sont des diversités de films et de sujets africains et afro-diasporiques qui sont présentés à Afrique en Vision. Cette année, on a choisi aussi de diversifier pour aller voir du côté des liens conjugaux, des liens familiaux, des liens maternels, ce qui se produit et qui est aussi inscrit dans une société, et donc forcément dans une politique, etc. Mais à côté de ça, il y a aussi des films à forte portée politique. Je pense notamment à Nationalité immigrée de Sidney Sokhona, qui sera présenté à la clôture du festival.
Justement, parlons de cette dimension politique. À travers votre programmation, vous souhaitez mettre en avant des récits qui traduisent des réalités, des défis, des aspirations du continent africain, mais aussi déconstruire certains imaginaires français. Quels sont ces imaginaires qui persistent ?
On peut constater qu’il y a quand même, dans une certaine partie de la France d’aujourd’hui, chez une certaine population, des regards un peu figés sur le continent africain, qui l’enferment dans les années de la colonisation ou dans les années très coloniales.
C’est un regard qui est souvent stéréotypé, qui va réduire le continent africain et les créativités africaines à certaines formes qui renvoient, selon le regard français, à quelque chose de folklorique. Et donc nous, avec Afriques en vision, on souhaite montrer l’autre regard sur le continent africain, à travers les récits de ces cinéastes, qu’ils soient actuels, contemporains, ou même des cinéastes qui nous ont quittés.
C’est pour ça aussi que, dans le festival, l’idée, c’est de montrer l’avant-gardisme de la vieille génération de cinéastes africains, qui ont pavé le chemin aux cinéastes actuels. Je pense notamment à une sélection de films autour de Mama Keïta, Johnson Traoré… Chaque année, on a un focus qui est porté sur les cinémas de matrimoine et de patrimoine du continent africain, pour montrer là aussi l’avant-gardisme des cinémas africains.
Le public français est-il prêt à voir et entendre ces récits ?
Oui. Nous constatons, on est à la cinquième édition du festival Afriques en vision, un public, qui est à la fois afro-diasporique, afro-descendant, mais aussi un public français qui vient justement à Afriques en vision parce qu’il n’a pas d’autres lieux pour voir des films africains inédits à ce moment-là. Et nous, on fait le choix dans le festival de présenter des films qui sortent peu dans les salles de cinéma françaises de proximité, bien qu’ils circulent dans les festivals les plus prestigieux à travers le monde.
Pourquoi ces films ne sont-ils pas diffusés dans les grandes salles de cinéma en France ?
C’est là aussi une problématique qui est liée à l’industrie même du cinéma en France. Il y a très peu de réseaux de distribution dédiés au cinéma africain, ou très peu de distributeurs français qui inscrivent les films africains dans leur catalogue. En France, il y a une société de distribution et de production unique, Sudu Connexion, basée à Paris, fondée par Claire Diao, qui est vraiment spécialisée dans les films du continent africain et afro-diasporiques. Mais comme l’initiative de Claire Diao, il n’y en a pas beaucoup. Quelques distributeurs français inscrivent des films du continent africain ou des films afro-diasporiques dans leur catalogue, mais très peu le font.
Il y a aussi une création cloisonnée au sein du continent africain. Quand on parle du continent africain, on parle aussi de zones linguistiques. Il y a les zones anglophones et francophones. C’est vrai que les distributeurs français sont plus ouverts aux zones du continent africain qui sont situées dans les parties francophones, et vont très peu, parfois, regarder les films issus des zones lusophones ou anglophones, par exemple.
Lors de la soirée de clôture, vous diffusez le docu-fiction Nationalité Immigré de Sidney Sokhona (1975). Ce film sur les conditions des travailleurs immigrés et le racisme est, selon vous, d’une actualité criante. Existe-t-il d’autres films anciens qui résonnent encore aujourd’hui ?
Oui, tout à fait. Alors, le film de Sokhona est assez marquant à ce niveau-là, parce que, certes, il parle de la lutte des ouvriers migrants à Paris dans les années 70, mais tout au long du film, on fait face à du racisme banalisé envers ces travailleurs, qu’on retrouve malheureusement aujourd’hui, en 2025, dans la société française, qu’il s’agisse d’investissements illégaux, de travailleurs ou, plus globalement, de personnes racisées.
Dans le festival, on a aussi un film qui s’appelle Reou Takh de Mahama Johnson Traoré, qu’on présente samedi matin au cinéma Utopia, et qui parle de la trajectoire d’un jeune Afro-Américain qui choisit d’aller au Sénégal pour voir par lui-même le Sénégal au lendemain de sa décolonisation, et se faire sa propre idée de ce qu’on appelle dans le monde anglophone les African Studies. Il souhaite confronter son regard d’Afro-descendant à la réalité du terrain.
Après la réalisatrice Sara Maldoror, vous allez rendre hommage cette année au réalisateur malien disparu en février, Souleymane Cissé. Vous allez diffuser son film Yeelen…Pour vous c’est quoi le style de Souleymane Cissé ?
Yeelen, c’est un film qui nous plonge dans un univers fantastique, mais fantastique universel. C’est un film qui vaut vraiment le détour, parce qu’il a été présenté à Cannes dans les années 80, et Souleymane Cissé nous a quittés en février 2025. Dans ce film, il redonne à l’imaginaire fantastique africain et mythique son titre de noblesse, en tirant des éléments du mysticisme africain.
C’est un film précieux, notamment pour la jeunesse, et précieux aussi pour l’un des objectifs du festival, qui est de donner un autre regard sur le continent africain. Parce que, voilà, on va souvent figer les imaginaires africains dans quelque chose de passéiste, alors que là, Souleymane Cissé nous propose tout à fait l’inverse.
Pourquoi les grands classiques du cinéma africain , comme ceux d’Ousmane Sembène, Djibril Diop Mambéty ou Souleymane Cissé, pour ne citer qu'eux, sont-ils si peu diffusés à la télévision, alors même que certains ont été co-produits avec la France ?
Je pense que c’est un choix, je dirais, politique, de ne pas prendre la peine de diffuser les classiques panafricains au même titre que les classiques américains ou européens. Ça fait partie aussi du chemin de l’évolution institutionnelle française, globalement, que de mettre le cinéma africain au même titre que les cinémas occidentaux, et de les passer à la télévision. Et même, j’irais plus loin : de les inscrire dans les programmes scolaires. Certains films peuvent avoir aussi une portée éducative et pédagogique qu’il convient d’inscrire dans les programmes scolaires. Yeelen en fait partie, La petite vendeuse de Soleil de Djibril Diop Mambéty aussi, et il y a plein de films qui méritent d’être même dans les programmes, au-delà d’être vus à la télévision.
Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nousEnvie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous

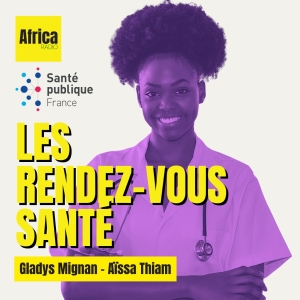




L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.