Motivée par le manque de données gouvernementales sur le nombre et les conditions de vie des jeunes migrants en attente de reconnaissance de minorité, la CNJED - la Coordination nationale Jeunes Exilé·es en Danger, qui rassemble des dizaines d'associations - a permis un recensement des jeunes présumés mineurs isolés engagés dans une procédure judiciaire. Au moins 3 273 jeunes vivent actuellement en errance en France métropolitaine.
Une reconnaissance inégale selon le département
Dans le détail, près d’un tiers des mineurs présumés recensés "vivent à la rue dans l’attente d’être vus par un juge des enfants ou par la cour d’appel". Les autres sont hébergés dans des structures solidaires ou dans des dispositifs d’urgence souvent inadaptés à leur profil. Avec ce travail, la CNJED souhaite alerter sur leurs conditions de vie alarmantes portant atteinte à leur santé physique et mentale.
Une hausse "préoccupante"
Une forte disparité territoriale a été observée par les enquêteurs selon les départements. En moyenne, 60% des jeunes obtiennent la reconnaissance de minorité, mais ce taux varie de 3% à 100% selon la ville où le jeune a été pris en charge.
Retrouvez le rapport complet sur notre site ➡️ https://t.co/3mAnkP4BX8
— Utopia 56 (@Utopia_56) September 25, 2025
"La part des jeunes filles recensées a presque doublé en un an", révèle l’enquête, passant de 5,98% en 2024 (soit 208 jeunes) à 10,85% en 2025 (soit 355 jeunes). Une hausse "préoccupante", au vu des risques spécifiques auxquels elles peuvent être confrontées. Chez les garçons, les chiffres sont en baisse : de 3 629 en 2024, ils passent à 2 918 en 2025.
Une prise en charge plus longue
Lorsqu’une personne se déclare mineure, un accueil provisoire est mis en place par la structure où elle se trouve. Ce délai de cinq jours permet aux évaluateurs de réaliser un examen de reconnaissance. Si un recours est engagé, l’attente peut s’étendre sur plusieurs mois, sans qu’aucune solution d’hébergement ne soit prévue par l’État.
Le travail mené par la CNJED vise à rendre visible cette réalité et à interpeller les pouvoirs publics. Même des institutions comme la Commission nationale consultative des droits de l’homme ou le Comité des droits de l’enfant de l’ONU – qui a condamnée à deux reprises la France – n’ont pas permis de faire évoluer la législation.
Bien que le chiffre de 3 273 soit une estimation vue à la baisse, elle met en lumière le manque de protection de ces jeunes, conclut la coordination. La CNJED plaide pour qu'une prise en charge soit mise en place dès la saisine du juge pour enfant.
Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nousEnvie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous

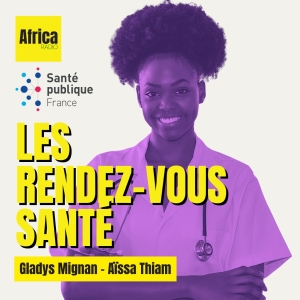




L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.