Vous êtes la présidente et fondatrice de Women in Afrofood, WINA, un réseau de femmes qui ont en commun de valoriser et de faire la promotion des cuisines africaines. Il y a une autre association qui s'appelle Umba Asso, l'Union des métiers de bouche
africains, qui a aussi cette ambition de créer aussi un réseau. Pourquoi il y a cette envie de fédérer aujourd'hui ?
Parce qu’on est quand même sur des industries qui sont porteuses, aussi bien du côté de l’Afrique que du côté de la diaspora.
L’idée, pour nous — à la différence de l’association qui a été citée —, c’est que nous, on va vraiment prendre les choses de "la fourche à la fourchette", parce qu’on estime que, lorsqu’on parle de chaîne de valeur, cela commence avant le produit, jusqu’à ce qu’il soit présenté dans une assiette, "packagé" ou transformé.
On sait que ce sont des secteurs porteurs, on sait qu’il y a de plus en plus d’entreprises et d’entrepreneurs à ce niveau. Comment est-ce qu’on se professionnalise ? Comment est-ce qu’on résout les enjeux ensemble ? Comment est-ce qu’on résout les différents problèmes ensemble ?
Parce qu’aujourd’hui, je pense qu’on a beaucoup parlé des cuisines asiatiques. Je pense que les cuisines africaines arrivent en force, et que c’est tout un écosystème à créer.
Vous voulez, avec Wina, défaire certains clichés, stéréotypes. Lesquels exactement ?
Il y en a tellement. On nous parle souvent de cuisine trop grasse, de cuisine pas healthy.
Et, j'ai toujours remarqué que lorsqu'on dit Made in Africa, il y a plein de clichés autour, il y a plein de méfiance, finalement, parce que ça vient d'Afrique, on va être deux fois ou dix fois plus prudent. "Est-ce que c'est de qualité ?", "Est-ce que c'est tracé ?", "Est-ce que c'est bien ?"
Il y a beaucoup de préjugés et même d'un point de vue entrepreneurial aussi. Lorsque vous dites made in Africa, les gens s'attendent à vous cantonner à un certain type de segment, tout simplement.
"Et l'idée de Women in Afrofood, c'est de dire que l’Afrofood, ça passe partout. On peut aussi être premium, on peut aussi faire des choses de qualité, qui sont goûteuses, bonnes, bien faites, et visuellement belles."
Encore aujourd'hui, il y a ces stéréotypes ?
Oui, le combat continue. C'est vrai que ça change. Ça change parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui sont conscients. Je pense qu'aussi bien du côté de l'Afrique que du côté de la diaspora, on a vraiment des porte-voix, on a vraiment des personnes qui sont là pour dire: "Écoutez, on va raconter l'histoire autrement. On va montrer qu'on
peut faire de belles choses. On va montrer qu'on peut rentrer dans différentes alimentations."
Et du coup, c'est vrai que c'est mieux par rapport à avant, mais le travail continue encore. Il ne faut pas forcément baisser en rythme, on va dire ça comme ça, mais il y a encore pas mal de préjugés et pas mal de travail aussi à faire de notre côté sur la façon dont on perçoit aussi nos produits. Ça va être très important.
On peut avoir une partie de la cible afro qui va te dire: "Moi, je comprends même pas que l'épicerie fine africaine existe", "Mais une épicerie fine, elle ne peut pas être africaine. Le poivre de Penja, on ne peut pas le vendre en épicerie fine. On le trouve sur tous les marchés", etc.
Il y a aussi ce travail de déconstruction à faire aussi à notre niveau pour nous dire: "Nos produits ont de la valeur". Et les autres communautés réussissent à le faire.
Je prends un exemple tendance : le matcha. Pourquoi est-ce que le moringa ne pourrait pas être ce que le matcha est aujourd'hui ? Ça commence par nous, parce que lorsqu'on
voit les Asiatiques, comment ils valorisent ce matcha, comment ils font des rituels autour... Il y a toute une histoire, c'est une expérience.
Donc ça vient déjà de nous. Comment est-ce qu'on voit nos propres produits et pouvoir les mettre au niveau qu'il faut et se dire: "On peut avoir des produits africains qui
sont premium, on peut avoir des produits africains qui respectent aujourd'hui des enjeux soit agroécologiques, biologiques, etc. On peut aussi penser à créer nos propres labels."
Vous voulez mettre en avant les contributions uniques de l'afrofood dans le monde. De quelles contributions vous parlez ? Est-ce que vous avez des exemples en tête ?
Nous, chez Women in Afrofood, c'est vraiment prendre la cuisine ou les cuisines, les produits comme du soft power, C'est-à-dire que nous, on va venir influencer, pas par la force, mais par les différentes ressources qu'on a. Et tout le monde aime bien
manger, finalement.
C'est-à-dire que l'afrofood, ça peut passer partout, ça peut influencer pas mal de choses. Lorsque je parle de contribution unique, je prends un exemple simple: le sans gluten,
par exemple.
L'Afrique n'a pas attendu l'Europe pour être sans gluten. C'est-à-dire que lorsqu'on
regarde dans l'histoire, la plupart de nos céréales sont sans gluten....
Le fonio, le teff...
Exactement, il y en a tellement.
Surtout du côté de la diaspora, on va rentrer dans des hypermarchés, où on va avoir des initiatives et finalement, on va se dire : "Mais ça, le sans gluten, on le connaît depuis, nous, on connaît tel produit".
Mais ce ne sont pas forcément des marques qui sont portées par nous et qui... Je ne veux pas dire qui nous font du bien à nous, mais qui vont nous apporter quelque chose.
Et quand je dis mettre en avant les contributions, par exemple, lorsqu'on a le sorgho, lorsqu'on a le mil, lorsqu'on a le manioc, nos femmes africaines utilisent ces céréales depuis la nuit des temps.
En fait, ce n'est pas nouveau. Finalement, ça va se passer comme un peu le chocolat, où le cacao, vient de chez nous, on le transforme en chocolat, on nous le renvoie à un prix plus cher.
On n'a pas attendu les autres pour faire du sans gluten, pourquoi pas s'approprier ces céréales-là ?
Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nousEnvie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous

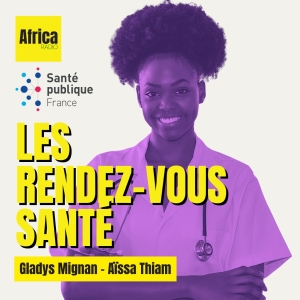




L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.