Vous avez découvert l’autobiographie de Malcolm X à l'âge de 16 ans. Qu'est-ce qui vous a marqué concernant sa vie ?
Ce qui m'a marqué de la vie de Malcolm X, c'est peut-être l'aspect “météorique”. C'est quelqu'un qui est mort jeune et qui a, on pourrait dire, vécu plusieurs vies en une seule, comme si la vie qu'il a menée n'aurait pas pu durer jusqu'à 80 ans ou 90 ans. Il y a ce côté très synthétique, intense qui est, à mes yeux, une partie importante ou une partie qui m'a marqué de sa trajectoire fulgurante.
Et concernant sa pensée ?
Ce qui me frappe chez lui, c'est en premier lieu sa conscience panafricaniste, c'est-à-dire que son insertion dans la lignée panafricaine, les traditions panafricaines qui abordent les expériences noires au-delà des États-Unis. C'est-à-dire, essayer de faire le lien avec les autres populations noires du monde et avec le continent africain. Ça, c'est un aspect qui m'intéresse tout particulièrement vu que je travaille sur la notion de diaspora noire africaine.
Cent ans après sa naissance et donc 60 ans après sa mort, Que reste-t-il de son influence, notamment aux États-Unis, mais aussi dans le monde ?
Je pense que l'influence de Malcolm X est toujours d'actualité. Je pense qu'il y a toujours des préoccupations panafricaines, panafricanistes à travers le monde. Son autobiographie fait partie quand même des best-sellers et des grandes autobiographies qui circulent aujourd'hui, qui se vendent, qui sont enseignées, malgré les attaques actuelles que l'on connaît aux États-Unis contre certains types de publications.
Il y a évidemment tout son héritage qui a été préservé par ses filles et par sa femme avant qu'elle ne meurt, Betty Shabazz.
Je sais qu'il fait partie de la collection du Musée d'histoire africaine-américaine qui a été inauguré par le président Obama en 2016, qui a organisé, à l'occasion de la célébration de son centenaire, un événement autour de lui, auquel a assisté l'une de ses filles.
Je sais que la mosquée à Harlem, qui s'appelle la Mosquée Malik Shabazz, a aussi célébré ce centenaire. C'est une figure qui est devenue iconique, qui est devenue inévitable aujourd'hui et qui a vraiment pénétré, on va dire, la psyché internationale panafricaniste.
- Lire aussi : "Frantz Fanon prônait un panafricanisme très fort", déclare la psychiatre, psychanalyste et écrivaine Alice Cherki
Il y a son héritage musulman aussi qui fait qu'il arrive à naviguer à travers les eaux de plusieurs mondes, le monde noir, le monde musulman.
Beaucoup d'extraits de ses discours sont repris et, parfois, ils peuvent être sortis de leur contexte. Y a-t-il eu, par moments, une instrumentalisation de la pensée de Malcolm X ?
Ce qui me vient immédiatement à l'esprit, ce sont peut-être les comparaisons systématiques qu'on a faites entre Malcolm X et Martin Luther King en les opposant.
Ça, c'est une construction qui a émergé après l'assassinat des deux hommes, de toute façon, et on a voulu imposer l'idée d'un Martin Luther King gentil et d’un Malcolm X méchant. Donc ça, je pense que c'est une forme d'instrumentalisation et une déformation de Malcolm, qui a été présenté comme hyper violent, comme raciste, comme racialiste, alors que vraiment, je pense que la vérité est bien plus nuancée.
C'est quelqu'un qui a milité, qui a milité pour les droits humains, quelqu'un qui a, comme je l'ai dit au départ, su transformer sa propre trajectoire, sa vie, qui s'est converti à l'islam par le biais de la Nation of Islam, qui ensuite a quitté la Nation of Islam et a suivi une voie musulmane plus orthodoxe. Qui a, et ça, c'était son vœu depuis le départ, essayé de tisser des liens avec la scène politique africaine-américaine et la scène politique internationale, notamment dans le contexte des indépendances et dans le contexte du Mouvement des Non-Alignés. Donc oui, moi, je pense qu'il y a eu une déformation.
Quand je pense à l'instrumentalisation, c'est une déformation de sa pensée qui l'a érigé en épouvantail. C'est le pire de ce que la cause noire pourrait donner si on suivait cette voie-là.
En 1946, Malcolm X est emprisonné pour des faits de délinquance. Il passera six ans en prison et c'est là-bas qu'il découvrira justement la Nation of Islam. C'est ce mouvement politico-religieux créé dans les années 30, dont il deviendra le porte-parole. Le mouvement prônait notamment la séparation des races, que Dieu est un homme noir et des hauts cadres, dont le mentor de Malcolm X, Elijah Muhammad tenait des propos antisémites également. Malcolm X, lui, quittera ce mouvement en 1963. Mais qu'est-ce qui va changer entre le discours qu'il va tenir au moment où il est à la Nation of Islam et dès qu'il quitte l'organisation ?
Déjà, pour revenir aux fondamentaux de la Nation of Islam, je ne sais pas si je qualifierais ce mouvement, ce groupe, de mouvement politique. C'est un mouvement qui est politique, évidemment, dans son essence. Mais en tout cas, ce n'est pas un groupe qui s'est inséré dans la lutte pour les droits civiques, par exemple. Ce n'est pas du tout la nature de la Nation of Islam.
Oui, ils prônaient la séparation…
Oui. Cette séparation impliquait un retrait de toute la vie étasunienne, et donc de la vie, notamment électorale et politique. Et l'une des grandes différences entre Malcolm X, qui est très tôt devenu le porte-parole de la Nation of Islam, c’est que Malcolm X, lui, voulait participer, voulait avoir une action politique plus concrète et pas seulement s'intéresser au dogme et à la circulation, enfin, au prosélytisme religieux.
Une fois que Malcolm X quitte la Nation of Islam, enfin, il la quitte et il en est aussi renvoyé, plus ou moins, il fonde immédiatement une nouvelle organisation qui s'appelle l'Organisation de l'Unité africaine-américaine, dont le modèle est l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OUA, qui a vu le jour sur le continent africain. Et là, il donne libre cours à ses ambitions internationalistes.
- Lire aussi : “Fanon” : “Le film montre une part méconnue de la guerre d’Algérie”, selon l’historien Amzat Boukari-Yabara
C'est-à-dire qu'il ne se limite plus à la seule condition noire africaine-américaine aux États-Unis, mais il s'intéresse à la question internationale de la condition noire. Et en cela, il s'inscrit dans la tradition panafricaine, parce qu'il ne faut pas oublier que les parents de Malcolm X étaient des adhérents de l'UNIA, Universal Negro Improvement Association, qui était l'organisation de Marcus Garvey, fondée au début du XXᵉ siècle.
Marcus Garvey est mort en 1940. Mais les parents de Malcolm X étaient des adhérents de l'UNIA. Donc, il y a quand même cette conscience, peut-être primaire, cette conscience dès l'enfance d'une vie ou de conditions qui nous mènent au-delà des États-Unis. La mère de Malcolm X était d'ailleurs originaire des Antilles.
Dans beaucoup de récits, on dit que c'est un pèlerinage à la Mecque qui lui fera changer sa vision des choses dans les années 60. Et dans ses discours, il va défendre que la cause africaine-américaine n'est pas seulement une affaire américaine, elle est aussi, donc, l'affaire de tous et il va aussi défendre d'autres causes. Mais est-ce que ce changement de posture a porté ses fruits et montré au monde l'autre face des États-Unis, qui est à cette période une superpuissance ?
Cette évolution de Malcolm X au début des années 60 est le reflet de l'évolution du Mouvement pour les droits civiques. C'est-à-dire qu'on a parlé d'une certaine forme de radicalisation à partir de la fin des années 60, avec l'émergence du mouvement Black Power, la fondation du mouvement des Black Panthers, Black Panther Party for Self-Defense, parce que c'est leur nom complet.
Il y a aussi le contexte international qui est propice à cette conscience, on va dire, globale. Encore une fois, cette conscience diasporique, puisqu'à partir de 1957, le Ghana accède à l'indépendance. Le Ghana, qui fait partie des pays africains visités par Malcolm X lors de sa tournée en Afrique et au Moyen-Orient.
Il y a vraiment aussi toute cette mouvance, tout cet espoir qui naît de ces nouvelles indépendances acquises des puissances coloniales européennes. C'est dans ce moment historique que s'inscrit Malcolm X. C'est juste un rappel : ce n’est pas un précurseur, Malcolm X, mais c'est quelqu'un qui s'inscrit dans cette généalogie, qui a essayé de forger des liens de solidarité avec d'autres pays, avec d'autres populations.
C'est cette conscience internationale qui va, par exemple, mener Malcolm X à envisager de porter des accusations pour maltraitance ou violation des droits humains, des États-Unis envers la communauté africaine-américaine, jusqu'à l'Organisation des Nations Unies, par exemple.
Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nousEnvie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous

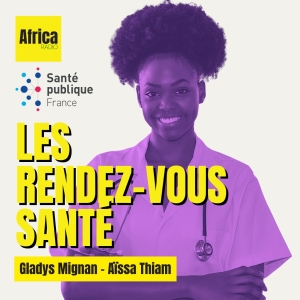




L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.