Le temps presse pour les négociations internationales en vue d’un traité sur la réduction mondiale du plastique, dont la fin est fixée au jeudi 14 août. Après l’échec de la première partie du sommet de Busan, en Corée du Sud, en 2023, ce dernier cycle réunissant près de 180 pays peine à avancer. Le président des pourparlers, Luis Vayas Valdivieso, diplomate équatorien, estime que les progrès des accords sont insuffisants. Si les États sont d’accord pour lutter contre cette crise planétaire, les moyens pour y parvenir diffèrent. Limiter la production ou améliorer la gestion du recyclage : deux visions s’opposent.
Face à la quantité phénoménale de déchets produits par les nations occidentales, certaines, comme la France, le Japon ou l’Allemagne, expédient leurs détritus vers d’autres pays.
- Un point sur le contexte : À Genève, l’Afrique réclame un traité global contre le plastique, face à la prudence des grands producteurs de pétrole
Pour Marine Bonavita, chargée de plaidoyer au sein de l’association Zero Waste France, ces exportations relèvent du "colonialisme des déchets". Ce terme a été entendu pour la première fois en 1989, lors des discussions menées par les groupes de travail sur la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux. Il désigne "le fait que les pays à hauts revenus utilisent soit leurs anciennes colonies, soit des pays à revenus faibles ou intermédiaires pour exporter leurs déchets", explique la chargée de plaidoyer.
Dernière ligne droite pour le traité plastique ! 💪 🏛️ Nous sommes cette semaine à Genève pour suivre l'évolution des négociations #inc52, et continuer à porter notre vision globale de l'économie circulaire, fondée sur la sobriété et le réemploi. La santé des générations futures est en jeu !
— Zero Waste France (@zerowastefrance.org) 12 août 2025 à 18:10
[image or embed]
Une véritable problématique, selon elle : "Parce qu’on déplace la pollution ailleurs et on impacte d’autres populations avec nos déchets." Depuis que la Chine a interdit l'importation de déchets plastiques en 2018, la Turquie est devenue la première destination pour ces déchets provenant d'Europe. En 2021 par exemple, près de 520 000 tonnes de déchets plastiques européens y sont arrivées, soit environ 43 000 tonnes par mois. Cela s'ajoute aux 4 à 6 millions de tonnes de déchets plastiques générés chaque année par la population turque elle-même.
L’ajout, en 2019, d’un nouvel amendement à la convention de Bâle, seuls les pays appartenant à l’OCDE - l'Organisation de coopération et de développement économiques - peuvent importer et exporter des déchets, tels que la Turquie, la Malaisie, la France, le Japon ou encore les États-Unis.
En 2023, cependant, un rapport publié par Human Rights Watch a alerté sur les conditions néfastes pour les travailleurs et les résidents vivant à proximité des usines de traitement des déchets en Turquie. Pour les pays receveurs, les déchets sont perçus comme une ressource économique. Pour Marine Bonavita : "Il y a donc une logique court-termiste : importer des déchets, recevoir une compensation financière, même si les infrastructures locales ne sont pas adaptées pour les traiter."
La réglementation en Afrique
Certains pays africains ont des politiques assez strictes vis-à-vis des plastiques, notamment sur les sacs plastiques, qui ont été interdits dans plusieurs pays. Certains ont même été pionniers dans cette interdiction. D’après la chargée de plaidoyer, le Rwanda, par exemple, est très "proactif au niveau international sur la question des plastiques." Il a commencé à déployer un arsenal juridique dès 2008, et l’interdiction des plastiques à usage unique est réellement entrée en vigueur avant 2020.
Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nousEnvie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous

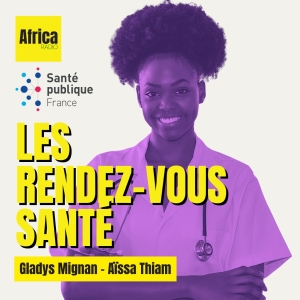




L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.