La France a mené une guerre au Cameroun. Emmanuel Macron, dirigeant français, a officiellement reconnu son existence mardi 12 août dans un courrier adressé à son homologue camerounais Paul Biya. Jamais un dirigeant français n’avait eu de mots aussi clairs sur le rôle de son pays dans ce conflit. Débuté pendant la période coloniale et poursuivi après l’indépendance de 1960, il a été marqué par une répression violente contre les mouvements indépendantistes, causant des milliers de morts.
Le Cameroun, ancienne colonie allemande avant la Première Guerre mondiale, a été divisé entre la France et le Royaume-Uni sous mandat de la Société des Nations (SDN) puis mis sous tutelle des Nations unis après la Seconde Guerre mondiale. Cette division en deux territoires distincts — le Cameroun français et le Cameroun britannique — a profondément marqué le pays, limitant dès le départ l’émergence d’une unité nationale.
🇫🇷 🇨🇲 Emmanuel Macron a officiellement reconnu que la France avait mené "une guerre" au Cameroun contre des mouvements insurrectionnels avant et après l'indépendance de 1960, marquée par des "violences répressives", dans un courrier à son homologue camerounais Paul Biya. pic.twitter.com/bMYIpcnWJI
— Agence France-Presse (@afpfr) August 12, 2025
Créé en 1948, l’Union des Populations du Cameroun (UPC) est le premier grand mouvement indépendantiste visant la réunification des deux Cameroun ainsi que la fin de la domination coloniale française rappelle Antony Guyon, historien et auteur du rapport de la commission franco-camerounaise. Son appel à l’indépendance totale et à la décolonisation fait rapidement de lui une cible prioritaire pour les autorités françaises.
Une guerre méconnue
La guerre éclate officiellement en mai 1955, lorsque la France dissout l’UPC, cherchant à étouffer toute revendication politique indépendante. Le conflit, longtemps qualifié de simple "pacification", s’inscrit dans le cadre plus large des guerres de décolonisation en l’Afrique dans les années 1950 et 1960.
Les autorités françaises mènent une répression féroce : arrestations arbitraires, exécutions sommaires, torture et déplacements forcés des populations civiles. Les chefs de l’UPC, tels que Ruben Um Nyobè, Paul Momo et Ernest Ouandié, sont traqués et éliminés, certains exécutés publiquement dans le but d’instaurer la terreur. L’assassinat de Félix-Roland Moumié, "empoisonné à Genève en 1960" précise Anthony Guyon, est également attribué aux services secrets français, bien que la France n’ait jamais reconnu officiellement sa responsabilité.
La doctrine de la guerre révolutionnaire
La stratégie militaire française s’inscrit dans une doctrine héritée des guerres coloniales, appelée "guerre révolutionnaire" selon l'historien. Celle-ci vise à détruire toute base sociale ou logistique du mouvement indépendantiste, notamment par la création de camps de regroupement.
Ces camps, appliqués également au Cambodge, sont mis en place notamment dans les régions de Sanaga Maritime et de l’Ouest Cameroun détaille l'historien. Ils sont conçus pour contrôler et surveiller les populations, souvent au prix de graves violations des droits humains : torture, mauvais traitements, humiliations systématiques et privation des libertés fondamentales.
L’indépendance sous influence
Le 1er janvier 1960, le Cameroun accède officiellement à l’indépendance. Mais la France, loin de tourner la page, maintient une influence forte en soutenant Amadou Ahidjo, Premier ministre choisi pour son alignement avec les intérêts français. Cette indépendance garantit la continuité des liens économiques, militaires et politiques entre Paris et Yaoundé.
Ce contrôle indirect s’inscrit dans une politique plus large connue sous le nom de "Françafrique", qui désigne les relations privilégiées, souvent opaques, entre la France et ses anciennes colonies africaines. Ainsi, même après l’indépendance, la répression contre les militants indépendantistes se poursuit, masquée par la mise en place de régimes autoritaires soutenus par Paris.
Une reconnaissance tardive, mais historique
Pendant des décennies, les gouvernements français successifs, de François Mitterrand à Nicolas Sarkozy, ont minimisé ou nié cette guerre. En 2009, François Fillon, alors chef du gouvernemnt, refusait d’admettre une responsabilité française. François Hollande, son successeur à la présidence, parlait seulement d’"événements" douloureux, sans reconnaître une guerre.
Le geste d’Emmanuel Macron en 2025, basé sur les conclusions d’une commission mixte franco-camerounaise créée en 2022, représente donc un tournant majeur. Cette commande du rapport conjointe des dirigeants européen et africains, met fin à des décennies de silence institutionnelle et ouvre la voie à une réconciliation autour de ce passé colonial violent. Le membre de la commission est optimiste quant à l'augmentation de l'intérêt des jeunes chercheurs pour ce sujet.
Toutefois, cette reconnaissance reste partielle, notamment en ce qui concerne la responsabilité dans l’assassinat de certains leaders comme Félix-Roland Moumié, ce qui continue de poser des questions sur la pleine prise en compte de l’histoire coloniale.
Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nousEnvie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous

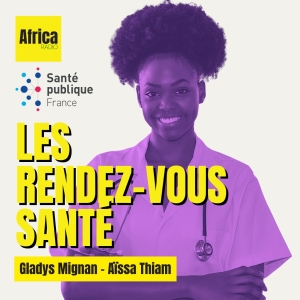




L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.