Avec Les Ombres du monde de Michel Bussi publié aux éditions de la Presse de la Cité, l’auteur quitte le polar traditionnel pour explorer un terrain plus sensible : celui du génocide rwandais de 1994. Ancien universitaire, fin connaisseur de la démocratie au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et du Rwanda, il s’appuie sur des années de recherches, de témoignages et d’archives pour construire un roman à la fois fictionelle et instructif. À travers le destin croisé de personnages imaginaires - Espérance, Jorick, Aline et Maé - et de figures historiques bien réelles, il retrace l’histoire du Rwanda sur trois décennies. Un récit mêlant émotion et transmission autour du génocide et de la responsabilité française.
Votre roman est structuré en trois actes, à travers le regard de trois générations : Espérance, une jeune professeure rwandaise dans les années qui précèdent le génocide ; sa fille Aline, rescapée élevée en France ; et Maé, sa petite-fille, qui découvre le Rwanda d’aujourd’hui. Pourquoi avoir choisi cette construction pour raconter cette histoire ?
"Je crois que c'était nécessaire, pour moi en tout cas. La génération de Maé, la petite fille, incarne le Rwanda moderne, avec ce regard un peu candide, d'abord sur le Kigali moderne, puis sur ce pays qui garde quand même de très grandes inégalités, une très grande pauvreté. Donc c'était important qu'à travers elle, on découvre le Rwanda sans a priori, dans toute sa complexité.
Et c'était très important aussi qu'on ait la génération des rescapés, à travers la mère de Maé, Aline, qui avait trois ans quand elle échappe au génocide et qui est élevée en France. C'est vrai qu'une grande partie des Rwandais qui vivent en France ou en Belgique, sont des orphelins qui ont échappé au génocide. Ils ont ce regard un peu particulier, puisque finalement ils n'ont pas connu ce pays, ils n'en ont pas de souvenirs directs. Evidemment, ce génocide est lié complètement à leur histoire, mais ils se sont construits presque parfois par opposition à ça, ils se sont construits pour l'oublier.
Je tenais à raconter cette histoire du Rwanda à partir d'octobre 1990, et pas seulement avril 1994, quand le génocide démarre. Pour moi, il fallait qu'on découvre ces années qui vont à la fois mener vers le génocide, mais qui aussi sont des années d'espoir pour le Rwanda, où on pense que le pays peut marcher vers la démocratie. C'était donc très important pour moi d'avoir Espérance, une jeune professeure qui pense que Tutsi et Hutu pourront pouvoir se réconcilier."
- À lire : Génocide des Tutsi au Rwanda. Le frère d'un génocidaire condamné en 2016 bénéficie d'un non-lieu
Pensez-vous que votre livre peut contribuer à faire avancer la mémoire collective, notamment en sensibilisant un public qui ignore encore le rôle qu’a joué l’armée française au Rwanda ?
"Oui, ça c'est vraiment le but du roman, c'était évidemment de procurer des émotions fortes aux lecteurs, mais en même temps, de faire œuvre de pédagogie, et que les gens qui vont refermer Les Ombres du monde aient l'impression d'avoir compris ce qui s'est joué au Rwanda avec beaucoup de dimensions. Que ce soit la dimension de l'invention des identités, des Hutu et des Tutsi, que ce soit comment se construit un génocide, ou comment on reconstruit un pays après un génocide, ou encore sur l'implication française à tout niveau dans ce génocide.
Il y avait énormément de dimensions, et oui, je tenais à ce que ce roman n'en néglige aucune. Ma fierté aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de retours sur ce livre. Presque tous font état d'une sidération de la part des lecteurs qui ne savaient rien, qui ne connaissaient rien, et qui ont découvert avec effroi à la fois les faits, mais aussi l'implication française. Et bien sûr, ce sont des gens qui, s'il n'y avait pas eu ce livre, n'auraient pas été lire des choses, lire des récits de géographie politique, etc. Il y a très peu de gens qui connaissent l'histoire du Rwanda et de l'implication française, en tout cas en en connaissant les détails."
- Lire aussi : Un ancien médecin rejugé en appel à Paris pour son implication dans le génocide au Rwanda
Avez-vous ressenti une forme d’autocensure, ou des hésitations, en écrivant certaines scènes particulièrement atroces ?
"J'ai lu énormément de récits de rescapés, et dans ces récits, presque toujours, il y a ces scènes de massacres de masse, souvent dans des stades, dans des églises, d'enfants qui meurent, de femmes qui meurent. Ces scènes-là, elles sont présentes dans tous les livres sur le Rwanda, et c'est impossible, évidemment, de passer à côté. On ne peut pas écrire sur le génocide sans écrire sur ces scènes-là.
Avec la littérature, on ne voit pas les corps, il y a quelque chose qui met à distance, donc je crois que la littérature procure une émotion. Le génocide en lui-même ne fait que peut-être un tiers du roman, donc il y a évidemment des scènes extrêmement terribles pendant le génocide, mais ce n'est pas tout le roman, loin de là. Il n'y a même, qu'une poignée de scènes, trois ou quatre chapitres, qui vont vraiment décrire l'horreur.
Je me suis beaucoup inspiré de Murambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop, qui avait écrit aussi un recueil de nouvelles sur le génocide. Il y a presque une forme d'ironie dramatique, quand on voit ces génocidaires qui vont faire les ibitero, c'est-à-dire ces chasses aux Tutsi, toute la journée, et puis qui rentrent le soir chez eux, pour manger, pour embrasser leurs enfants, et plaisanter, parce qu'ils ont une journée fatiguante, oui, il y a une forme d'ironie dramatique. Mettre en avant ces scènes de la vie ordinaire, où des braves mères de famille vont préparer à manger pour les hommes qui reviennent fatigués, et que ces hommes racontent comment ils ont tué, assassiné, il y a quelque chose qui est à la fois atroce, mais qui devient une forme d'absurdité, voilà, et ça, la littérature permet de le rendre."
Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nousEnvie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous

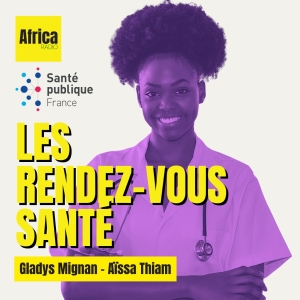




L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.