Il y a treize ans, vous avez donné une conférence TED où vous disiez que l’Afrique était définie par la corruption, la pauvreté et l’aide internationale et que cela vous mettait en colère. Est-ce quelque chose que vous diriez encore aujourd’hui, ou bien la situation a-t-elle évolué ?
Oui, la situation a évolué, mais on est encore loin du compte. Il y a encore beaucoup d’endroits où l’Afrique est perçue à travers le prisme de la pauvreté, de la corruption, des conflits et du manque de leadership. Ces stéréotypes existent toujours. Nous avons des données, nous avons fait des recherches qui le prouvent.
Mais cela dit, nous avançons sur de nombreux fronts. D’abord, le continent a réellement progressé, il y a beaucoup de changements aujourd’hui. Ensuite, nos dirigeants prennent davantage leurs responsabilités. Ils semblent avoir plus d’assurance et de poids sur la scène publique. Donc il y a du mouvement.
Africa No Filter a récemment publié un rapport, un Global Media Index, dans lequel vous avez classé et analysé la façon dont 20 grands médias internationaux couvrent l’Afrique, selon la diversité des sujets, la variété des sources, le nombre de pays concernés et la profondeur du traitement. Ce qui en ressort, c’est que l’Afrique est encore souvent décrite à travers la politique, la pauvreté et la corruption, que les voix africaines ordinaires restent absentes, et que la couverture médiatique se concentre sur un petit nombre de pays. Est-ce que ces résultats vous ont surprise ?
On nous pose souvent cette question. Non, les résultats ne sont pas surprenants. Je pense que la raison pour laquelle nous faisons cette recherche, c’est justement pour documenter nos constats. On pense souvent que les médias internationaux sont biaisés contre l’Afrique, mais cet indice mondial des médias en apporte la preuve concrète, il montre où se trouvent ces biais et à quel point le problème est important.
Par exemple, on sait que beaucoup d’articles continuent de se concentrer sur les conflits en Afrique ou sur des cas de mauvais leadership. Mais où sont les histoires qui parlent de progrès, d’opportunités, de créativité et d’innovation ? Où sont les récits sur nos arts, nos cultures, nos imaginaires ?
À l’inverse, quand on parle de l’Afrique, c’est aussi souvent sous l’angle de l’évasion, de la nature et des safaris. Comment trouver un équilibre pour que la couverture du continent soit plus juste et plus représentative ?
C’est justement la question à laquelle l’Afrique essaie aussi de répondre. La solution paraît simple, mais elle est très difficile à mettre en œuvre. Il faut changer les histoires que nous diffusons dans l’écosystème médiatique. Nous devons avoir plus d’histoires, de meilleures histoires, et des histoires mieux racontées.
Quand on parle de meilleures histoires, on parle de celles qui mettent en avant les innovateurs, les jeunes entrepreneurs, les personnes qui font bouger les choses, qui créent, qui progressent. Le continent est jeune, et partout, de nombreux jeunes accomplissent des choses incroyables. Il faut raconter davantage ces histoires-là : elles inspirent, informent, éduquent et on n’en a pas assez. On ne parle pas assez de nos héros.
Mais d’un autre côté, il est vrai qu’il y a aussi des récits de conflits, parce que les conflits existent en Afrique. Il y a de la corruption, c’est une réalité. Nous ne sommes pas là pour faire de la propagande ou une campagne de relations publiques pour l’Afrique. Nous ne disons pas que tout va bien ou que tout est parfait, ce serait manquer de crédibilité.
Vous dites aussi souvent qu’il est essentiel que les Africains racontent leurs propres histoires, et vous utilisez ce proverbe : « Tant que les lions n’auront pas leurs propres conteurs, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur. » Qui sont, selon vous, les chasseurs ?
Eh bien, en ce moment, ce sont ceux qui tiennent le stylo, autrement dit, ceux qui contrôlent le récit. Quand nous avons réalisé un rapport intitulé Comment les médias africains couvrent l’Afrique, il faut bien se rappeler que ce rapport portait justement sur la manière dont les médias africains eux-mêmes parlent de l’Afrique. Et nous avons découvert que, dans la plupart des pays africains, les informations sur les autres pays du continent provenaient surtout de l’AFP ou de Reuters, des agences de presse internationales, pas africaines. Ces institutions n’appartiennent pas à des Africains, elles n’ont pas d’agenda africain, mais un agenda global.
- Lire aussi : Pourquoi l’Afrique paraît-elle plus petite sur les cartes du monde (et comment l’Union africaine veut changer ça) ?
Ainsi, ceux que nous appelons les chasseurs, ce sont en réalité ceux qui détiennent le stylo et la plupart ne sont pas Africains. L’un des grands problèmes à résoudre, c’est justement la question de la propriété des plateformes. Nous ne possédons aucune des grandes plateformes de médias sociaux : ni Facebook, ni Meta, ni Instagram, ni X (ex-Twitter). Même pour les plateformes d’intelligence artificielle comme OpenAI, nous n’en possédons aucune.
Il existe de nombreux médias indépendants et sérieux sur le continent, comme The Republic au Nigeria ou The Continent, entre autres, mais il reste des défis, notamment en matière de moyens, de liberté d’expression et du droit d’informer, qui varient beaucoup selon les pays. Comment construire un paysage médiatique africain plus solide, où les journalistes peuvent raconter leurs histoires librement et en sécurité ?
Certains des problèmes que rencontrent les médias africains sont aussi des problèmes mondiaux. Partout dans le monde, les médias traversent une crise, notamment parce qu’il existe aujourd’hui de nombreuses autres sources d’information. La désinformation, les fausses nouvelles et les réseaux sociaux ont profondément bouleversé le paysage médiatique.
Mais selon moi, ce que nous, Africains, devons faire, c’est investir dans les médias. Pas dans les médias pour servir un agenda particulier, mais dans les médias pour ce qu’ils sont : un pilier essentiel de la société. Il y a très peu de financement pour développer les médias, pour construire de vraies plateformes médiatiques sur le continent africain. C’est quelque chose que nous défendons : investir dans les médias africains.
Ce que nous constatons aussi, c’est que beaucoup de médias dépendent de financements extérieurs qui ne proviennent ni d’entreprises locales ni de la publicité. Souvent, cet argent vient d’organisations philanthropiques du Nord global, qui, elles aussi, ont leurs propres agendas. Elles vous financent pour produire des contenus sur certains thèmes, par exemple le genre, le climat, ou d’autres sujets précis, mais pas pour faire fonctionner la rédaction au quotidien. Elles ne financent pas pour “éclairer”, mais pour influencer les décideurs politiques à travers les contenus.
Il faut donc changer ce modèle. Les médias doivent pouvoir être financés depuis le continent, par des investissements africains, afin de se développer comme de véritables entreprises.
Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nousEnvie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous

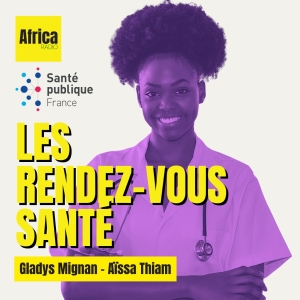




L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.