Laetitia, 41 ans, est originaire de la République démocratique du Congo. Elle est arrivée en France à l’âge de quatre ans. Mariée et maman d’un enfant âgé de 8 ans, sa vie a complètement changé lorsqu’elle découvre que son fils a des troubles du spectre autistique. Une situation compliquée pour la maman, qui aura d’abord du mal à accepter la situation. "Dans mon entourage, des gens ont été confrontés à ça. C'est très mal pris en charge en France", explique l'ancienne responsable des achats, qui a pris la décision de s'occuper à plein temps de son fils.
À cette observation, s'ajoute l'inquiétude qu'il subisse le syndrome méditerranéen, un stéréotype présent chez certains professionnels de santé. Pour eux, les personnes africaines, du pourtour méditerranéen, exagèrent la manifestation de leur physique et psychique. “ "Je l'ai vécu une fois, je ne voulais qu'il soit confronté à ça, explique Laetitia. [En France], on ne voit pas l'appartenance ethnique de la population. Tout le monde est pareil. Mais tous les jours, on est confronté à une réalité qui est une mauvaise compréhension, appréhension des communautés étrangères”, regrette-t-elle.
Un rapport du Défenseur des Droits, publié en mai, s'appuyant sur plus de 1 500 témoignages, ointe les nombreuses discriminations existant dans les parcours de soins en France. Au-delà du "syndrome méditerranéen", l'étude dénonce un éventail plus large de pratiques inégalitaires. Le Défenseur des Droits pointe explicitement le refus de soins, la minimisation de la douleur et une prise en charge inégale qui ne se limitent pas à l'origine. Des critères tels que le genre, le handicap et la précarité sociale.
Pour son fils, Laetitia a décidé de se documenter et de prendre contact avec des associations, des professeurs anglo-saxons, car ils prennent en compte l’identité culturelle de la personne, et va se tourner vers des psychologues afrodescendants et l’ethnopsychiatrie, une spécialité de la psychiatrie qui cherche à comprendre comment la culture d’un patient influence sa manière de vivre, d’exprimer et de soigner sa souffrance mentale.
Cette discipline s'intéresse surtout aux personnes issues de cultures non occidentales (comme les migrants, réfugiés, etc.) et adapte les soins en tenant compte de leurs croyances, traditions et modes de pensée.
Sur internet, en particulier sur les réseaux sociaux, certains Africains et des Afrodescendants recherchent des professionnels de santé bienveillants ou les ressemblant culturellement.
En France, des sites, des associations ont vu le jour et cataloguent des professionnels de santé à destination des personnes noires, mais aussi exilées ou LGBTQI+ (Association santé mentale de la marge au centre, plateforme dédiée aux "médecins LGBT Friendly, etc.).
“C'est vrai qu'il y a un manque de prise en compte du contexte culturel…”
“Ça peut être important que le psy nous ressemble sur le plan culturel, ethnique ou spirituel. Par exemple, beaucoup de patients vont chercher un psy qui croit en Dieu, car ils ne vont pas être obligés de justifier le moment où ils vont en parler”, explique Aurélie Barnabot, spécialiste en psychologie intégrative.
Si en tant que professionnelle de santé, elle accueille tous les patients, la majorité d’entre eux sont des femmes afrodescendantes.
Ces dernières se sont adressées à elle parce qu’elles se sentaient incomprises. “C'est vrai qu'il y a un manque de prise en compte du contexte culturel, etc. Parfois, il y a une invisibilisation, que ce soit du racisme, du sexisme, des microagressions, explique-t-elle. Par exemple, quand une femme noire parle d'avoir été suivie par des vigiles en magasin, de devoir sur performer au travail pour être vue comme légitime, il y a des psychologues qui vont minimiser tout ça, qui vont rationaliser, déplacer la conversation avec des phrases comme : ‘Mais peut-être que ce n'est pas lié à votre couleur de peau’, ‘cela n’a rien à voir avec votre origine’”, détaille la psychologue. Résultat, les patientes préfèrent mettre fin à la thérapie.
Cela a été le cas de Yolande, Sénégalaise, mariée et mère de deux enfants. Comme Laetitia, elle s’est également tournée vers l’ethnopsychiatrie, après avoir enchaîné les échecs avec d’autres psychologues et psychiatres. “Pour moi, l'écoute n'était pas suffisante. Il fallait une connexion avec le psychologue ou avec le psychiatre pour être à l'aise, pour pouvoir divulguer certaines choses. Et je ne l'ai pas ressenti avec eux”, explique-t-elle.
La femme a grandi dans un foyer où les questions de santé mentale sont “tabous”. "Quand je ne me sens pas bien, je ne peux pas parler de déprime, ce mot n’existe pas”, relate-t-elle.
“Si on ne se sent pas compétent parce que la demande est plus liée à un contexte culturel, on l'adresse à un collègue”
Dans le domaine de la psychologie, plusieurs champs existent pour répondre à une problématique spécifique. “On a cinq spécialités de masters et il y a des parcours un petit peu différenciés à l'intérieur de ces cinq masters”, explique Gladys Mondière, psychologue et présidente de la Fédération française des psychologues et de la psychologie. Si les professionnels ne choisissent pas les mêmes spécialités, la base de leur métier est de “pouvoir travailler avec tout le monde, accueillir l’autre dans ce qu’il est, dans sa différence”, souligne-t-elle, en rappelant le code de déontologie de la profession. “Si on ne se sent pas compétent parce que la demande est plus liée à un contexte culturel, on l'adresse à un collègue.”
Si la question de l’identité culturelle devient un sujet dans la profession, pour certains, il y a encore du chemin pour qu’elle soit pleinement considérée. Racky Ka-Sy, docteure en psychologie sociale, dispense des formations sur le racisme et les discriminations auprès de professionnels de santé, mais aussi auprès d’entreprises et d’institutions publiques. Elle a également donné une conférence à la Faculté de Santé de l’Université Paris Cité sur l’impact des discriminations raciales sur la santé.
Pour elle, la formation de base n’est pas adaptée. Si c’est une bonne idée pour les professionnels de suivre des cours complémentaires, comme l’ethnopsychiatrie, afin d’acquérir davantage de connaissances, bien qu'elle reproche une tendance à l’essentialisation.“C’est-à-dire estimer que les personnes de tel pays, de telles conditions sont comme ça, sans qu’il y ait de remise en question”, clarifie-t-elle.
Des critiques qu’a souvent entendues Jean-Oscar Makasso, docteur en psychopathologie clinique, psychanalyste et ethnopsychologue, en plus du fait que pour certains, ce n'est pas seulement la culture qui répond aux critères de la maladie ou bien aux critères de l'éducation sociale.
L’empathie, l’humilité... Les clés d’une prise en charge réussie
Pour le fondateur de la Maison Soundiata Keita, dans le XXe arrondissement de Paris, dédiée notamment aux familles migrantes, “il faut tenir compte de l'environnement, des codes de l'autre, de la langue de l'autre, pour essayer de comprendre le patient”, souligne-t-il, en ajoutant que cette discipline est une surtout une complémentarité.
Si la compréhension de l’identité culturelle demeure un critère important pour certains patients dans le choix du psychologue, Aurélie Barnabot, Gladys Mondière et Racky Ka-Sy s’accordent pour dire que la posture du professionnel de santé est primordiale. “Si on a un professionnel qui est formé, qui est humble, qui est ouvert, qui est capable vraiment d'une empathie profonde et qui peut vraiment offrir un espace hyper sécurisé, même s’il n’a pas vécu ou ne vit pas la même réalité, ça peut être bon aussi”, souligne Aurélie Barnabot. Et ce, que le patient mette en avant son identité culturelle ou non.
Envie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nousEnvie d'afficher votre publicité ?
Contactez-nous

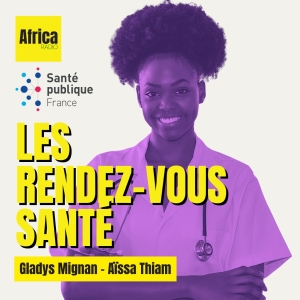




L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.